
L'argument
Amis lecteurs prenez garde! Ce livre-manifeste traite de la poésie dans l'architecture. La poésie quelle horreur. Dès que l'on aborde la question, le ricanement issu du fond de nos cours de récréation remonte bientôt : "amis poètes, bonjour" Tout est dit. Et pourtant quelque chose vient de vraiment changer : c'est ce que nous vous invitons à découvrir. Il nous faut pour cela quitter le clapotis de nos habituelles conversations de mouettes rieuses, fermer nos oreilles comme des écoutilles et nous enfoncer pour une fois dans la profondeur des choses. Attention, tout y est plus beau mais il y fait froid et noir. Il va falloir s'habituer à regarder autrement que par les yeux.
Êtes-vous d'accord?
Plongeons.
Préface de Jean-Noël Cordier,
Vice-président de la Société des Poètes Français.
L'extrait
Et la couleur ?
Pour nous qui n'avons jamais fait un trait pour dessiner mais parce que nous avions quelque chose à dire, la couleur en architecture, comme celle du peintre, est l'expression même du bâtiment, l'indispensable halo de contact entre lui et nous. Là encore, par une curieuse époque qui tolère bien des abus, est-elle aujourd'hui bannie. Le blanc cassé jaune est notre consensus. "Quand les cathédrales étaient blanches" ? mais elles étaient colorées!
Alors bien sûr comme les couleurs criardes et vives sont dans la ville l'apanage des publicités et des enseignes vulgaires, certains ont cru s'en sortir en se disant qu'ils suffisait de construire des bâtiments gris ou monochromes pour s'éloigner de cette grossièreté. Mais ce ne sont là que les deux faces d'une même pièce : bavarder ou se taire, c'est toujours ne rien dire. En réalité, la couleur apporte une vibration à votre projet que rien d'autre ne pourra lui donner.
Elle est sa vie même, et plus encore, celle de l'âme de l'architecte. Par elle, sommes-nous renseigné très sûrement si malgré la rigueur de son bâtiment, l'architecte était doux, malgré l'étroitesse de sa réalisation, il était généreux.
Négliger la couleur, voilà le vrai crime. Baudelaire n'écrivait pas en noir
et blanc.
Préface
A la poésie de l’architecture
Voici un livre proprement extraordinaire, au sens étymologique un livre qui n’a
pas de précédent. Malgré certaines apparences techniques, cet ouvrage est de la
pensée pure, et la pensée, le « mens » latin, s’y édifie page à page. A travers les
divers chapitres qui le constituent et qui peuvent paraître quelquefois autonomes les
uns par rapport, les autres y entonnent un hymne continu à la vie, et chantent ses
bienfaisants et féconds miracles.
A la poésie de l’architecture, titre à priori énigmatique et inattendu, définit à lui
seul un projet et suggère un programme. Il s’inspire de Marcel Proust auquel
curieusement l’un des premiers chapitres est en partie consacré, donnant ainsi
appui à la démarche des auteurs. A la recherche du temps perdu, en effet, tente de
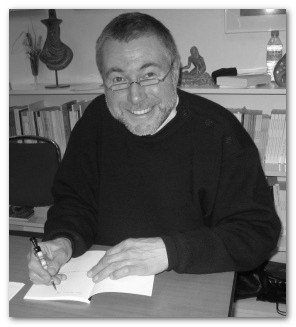 reconstruire, à travers le prisme poétique du souvenir une cathédrale intemporelle.
A la poésie de l’architecture souhaite retrouver la poésie des édifices matériels.
Proust n’avait-il pas écrit : « Le monde n’a pas été crée une fois mais autant de fois
qu’un artiste original est survenu ? » Sans aucun doute s’agit-il là d’un hommage.
Il est inhabituel cependant, d’asseoir architecture et poésie, cette dernière relevant
de l’immatériel, la première suggérant au contraire un jeu souvent périlleux sur
la matière. En fait, la cohérence est entière puisque le visible n’étant que le reflet
de l’invisible, la mise en espace de la matière n’est autre que la projection, la
mise en forme de la pensée. « Pittura e cosa mentale » (La peinture est chose
mentale), reconnaissait Léonard de Vinci. De sorte que la poésie et l’architecture,
autrement dit la pensée et sa réalisation matérielle apparaissent indissociables.
Faut-il rapporter que le terme « poésie » provient du grec « poïn » qui signifie «
crier », « fabriquer », « façonner » ? Ainsi que tout vrai travail sur la matière, ainsi
que tout art véritable, l’architecture est donc une forme de poésie, et l’architecture un
créateur qui conçoit et construit.
reconstruire, à travers le prisme poétique du souvenir une cathédrale intemporelle.
A la poésie de l’architecture souhaite retrouver la poésie des édifices matériels.
Proust n’avait-il pas écrit : « Le monde n’a pas été crée une fois mais autant de fois
qu’un artiste original est survenu ? » Sans aucun doute s’agit-il là d’un hommage.
Il est inhabituel cependant, d’asseoir architecture et poésie, cette dernière relevant
de l’immatériel, la première suggérant au contraire un jeu souvent périlleux sur
la matière. En fait, la cohérence est entière puisque le visible n’étant que le reflet
de l’invisible, la mise en espace de la matière n’est autre que la projection, la
mise en forme de la pensée. « Pittura e cosa mentale » (La peinture est chose
mentale), reconnaissait Léonard de Vinci. De sorte que la poésie et l’architecture,
autrement dit la pensée et sa réalisation matérielle apparaissent indissociables.
Faut-il rapporter que le terme « poésie » provient du grec « poïn » qui signifie «
crier », « fabriquer », « façonner » ? Ainsi que tout vrai travail sur la matière, ainsi
que tout art véritable, l’architecture est donc une forme de poésie, et l’architecture un
créateur qui conçoit et construit.
Cependant, on peut envisager l’architecture selon deux points de vue. Ou bien
comme une simple réponse utilitaire aux besoins fondamentaux de la vie, ou bien
comme une création pure de l’esprit, en lien cependant avec ces besoins. Et cet
art convaincra d’autant plus qu’il joindra « l’utile et l’agréable ». C’est bien entendu
dans cette voie que se sont engagés Isabelle Coste et David Orbach. La riche
iconographie en témoigne. Pour nos deux architectes, le beau n’est pas un luxe
pour nantis, mais bien une nécessité inhérente à la vie. L’utile ne saurait être laid, et
l’utile sera d’autant plus pertinent qu’il sera beau. Certes le beau peut coûter cher,
mais pas forcément. J’en veux pour preuve cette crèche sans intérêt des années
50 qu’une municipalité se refusait à démolir par souci d’économie, et refaçonnée
par nos poètes-architectes en lieu d’accueil aux jeux de l’enfance. Ou encore cette
banale villa de Fontenay-aux-roses qui trouve enfin forme et signification.
Isabelle Coste et David
Orbach tendent ainsi à s’inscrire dans une histoire, l’histoire
des hommes et des choses, notre histoire commune et fraternelle. Contrairement à
bon nombre de créateurs contemporains, leur art ne se veut ni rupture, ni gratuite
originalité. Si cet art peut surprendre, il ne cherche nullement à choquer. S’inscrivant
en faux face à certaines dérives de certains architectes contemporains, sans lien
avec la vie, cet art se veut au contraire en prise sur la vraie vie, la vie quotidienne,
ce qui ne signifie pas pour autant la banalité. Aussi bien dans leur réhabilitations
que dans leurs créations originales, c’est le bien être dans l’espace que visent
Isabelle Coste et David Orbach. Leur modernité, incontestable, se manifeste par
la réappropriation de symboles immémoriaux tels la sphère et le carré. Ils incitent
à porter un nouveau regard sur la couleur. Modernité donc, sans agressivité. Ils
font appel à des formes apaisantes, à des images reposantes. Nature et végétation
inspirent de vastes et doux panneaux en images numérisées. De larges baies
s’ouvrent sur des jardins ingénieusement, mais harmonieusement recomposés.
Les sens doivent être n’ont pas étouffés, mais sollicités. Lieu de vie, l’espace ne
saurait être lieu d’enfermement égoïste mais bien lieu d’ouverture et de découverte
et d’interrogation. Aussi l’espace favorise-t-il un apprentissage permanent, mais
structurant où triomphe la lumière.
Résolument moderne, cette architecture ne saurait donc « dater », dans la mesure
où elle s’inscrit dans une atemporelle modernité. Elle trouve tout son sens dans la
vérité platonicienne. Seul le vrai peut être beau, seul le beau peut être vrai. Rendre
intelligibles les mystérieuse correspondances entre la Nature et l’Homme, rendre
claires et lisibles les aspirations parfois obscures de la pensée, unir le ciel et la terre,
la matière et l’esprit en des lieux de vie, telle est l’harmonieuse exigence d’Isabelle
Coste et David Orbach, telles sont la forme et l’expression de la poésie.
Jean-Noël Cordier
Paris, 28 janvier 2011
Données techniques
Isabelle Coste et David Orbach
A la poésie de l’architecture
Essai
Collection
Portes
148 pages
Parution courant 2012
18
euros
ISBN : 978-2-919483-05-1